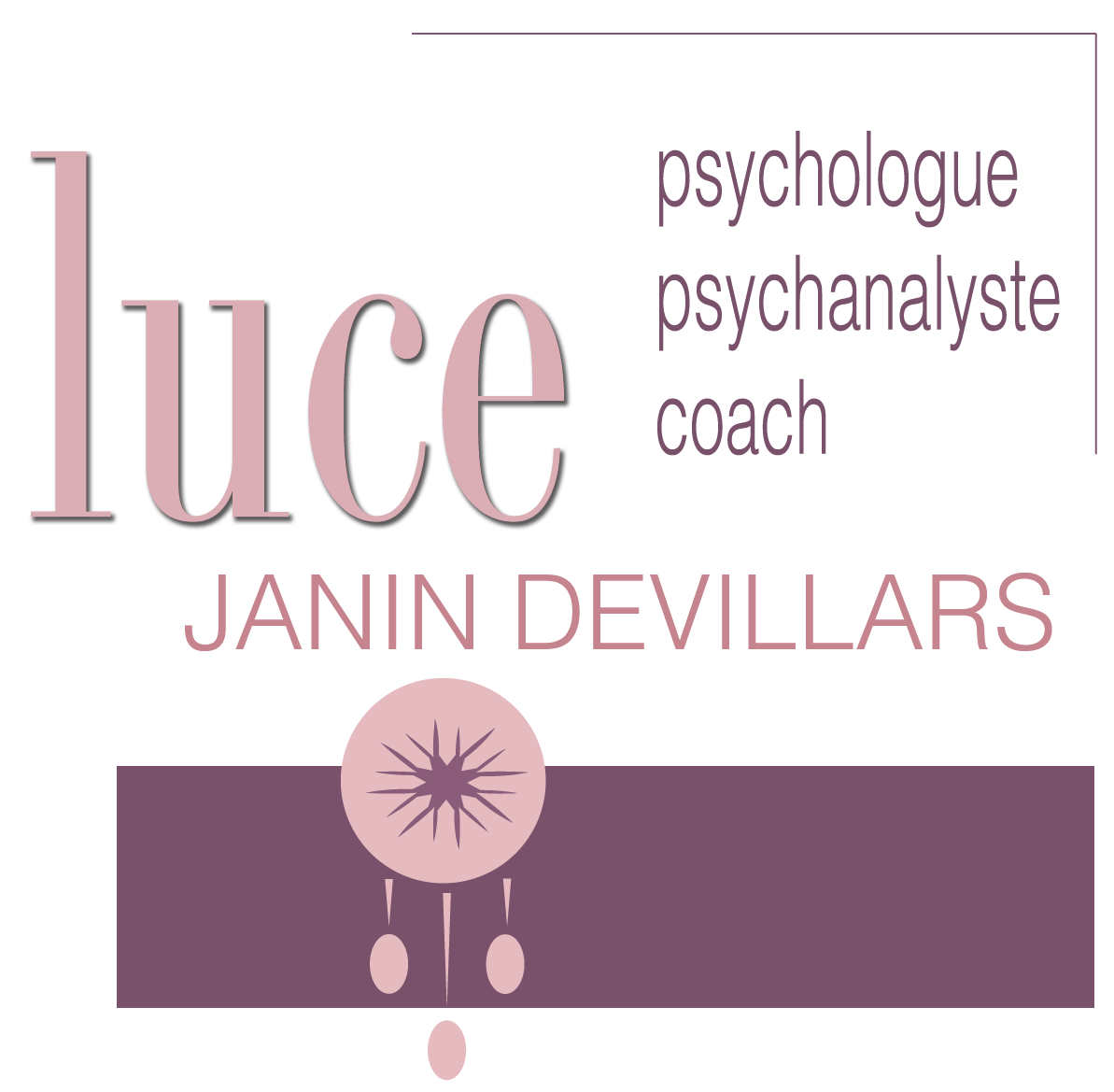De la vocation à l’addiction
La métamorphose
Je ne suis pas une spécialiste de la drogue. Ce qui m’intéresse, ce sont les avatars, les métamorphoses d’une existence. Ces trajectoires de vie dans lesquelles chacun de nous s’engage, plus ou moins volontairement, souvent de manière parfaitement inconsciente, à partir de l’environnement, de la culture qui nous ont été conférés de naissance – c’est dire notre impuissance en ce domaine – mais aussi à partir de notre histoire telle que nous l’avons désirée et, plus ou moins, contrôlée. Des travaux consacrés aux trajectoires d’ascension et de descension sociale m’ont amené à réfléchir sur les mécanismes psycho-sociaux à l’oeuvre dans ces différents processus. Ce qui faisait qu’un individu ordinaire, marqué du sceau de l’insertion – famille, emploi, appartement – se retrouvait, parfois brutalement, en situation de déshérence absolue.
Ces questions posant naturellement le référent contraire : qu’est-ce que la réussite quand elle se poursuit, souvent d’une génération à l’autre ? En collectant des récits de success stories sur plusieurs générations, je me suis aperçue que la transmission d’un savoir-faire, manuel ou intellectuel, constituait un facteur d’accomplissement important, en particulier quand le fil professionnel, tissé et renforcé à chaque génération, débouchait sur l’émergence d’une vocation chez l’un des membres de la fratrie.
La vocation
La vocation, quand elle surgit, apparaît le plus souvent, aux yeux de celui qui la vit comme aux yeux de son entourage, ainsi qu’une sorte de mouvement magique, un sortilège qui placerait le sujet devant la nécessité absolue de s’engager dans telle direction et d’y réussir. Or aucun de nous ne peut prétendre qu’il est la victime désignée d’un éros mythique, petit dieu amoureux qui tirerait une flèche dans notre direction sans nous donner la possibilité de refuser. La vocation est transgénérationnelle. Elle implique un individu mais le replace au coeur d’une très longue histoire, au sens historique du terme.
En même temps, la vocation n’est pas seulement ce mot hautement valorisé par l’imaginaire populaire qui va conduire l’élu vers un destin conçu pour lui seul de toute éternité. J’ai fréquemment constaté que le chemin est parfois très étroit entre le désir de s’engager dans une voie ou une autre et cet impitoyable lien qui unit l’alcoolique à l’alcool ou le déprimé à son psychotrope. Comment une activité ou un produit, qui paraissent avoir été rencontrés par hasard – mais non sans raison – peuvent-ils s’instaurer comme le centre même du désir et de la jouissance d’une personne.
L’addiction
En écoutant des addicts, au sens habituel du terme, je me suis aperçue que la plupart d’entre eux évoquaient l’abus de produits licites ou illicites, mais toujours dangereux, en les banalisant comme s’il s’agissait d’une conduite de modernité ordinaire. Un ordinaire souvent associé à la performance. Grâce au cannabis, on pourrait écouter de la musique de manière différente : l’émotion ressentie serait plus forte et plus profonde. L’usage répété entraînerait le développement de certains canaux sensoriels comme on développe ses muscles en faisant de la gymnastique.
En écoutant des sportifs de haut niveau, des passionnés d’informatique ou de danse, j’ai ressenti la même impression. Les récits étaient différents, structurés par un régime alimentaire draconien, rythmés par le temps d’apprentissage de la danse, les entraînements, les répétitions.
Pourtant, dans les deux cas, des mots, identiques, me revenaient en écho : défoncé, cassé, usé, meilleur, plus cool et, bien sûr, plus performant. Or le fait de se défoncer, d’être cassé, paraissait, pour beaucoup, représenter un comportement particulièrement moderne, à l’intérieur de ce que je suis bien obligée de nommer une pathologie de l’excès, devenue non la règle de tous mais l’ordinaire de certains.
La culture et la modernité
Ce terme de modernité m’a semblé bizarre parce qu’elle conférait au mot une sorte de qualité, de ressource que ses effets démentaient. Je savais bien qu’aucune culture, qu’aucune société n’avait échappé à l’utilisation de substances, inutiles à leur survie, destinées à donner accès à l’invisible : communiquer avec les ancêtres morts, recevoir conseils et soins de la part de l’inconnaissable et du divin, l’ayahuasca – plante hallucinogène – chez certaines tribus indiennes par exemple.
En France, la consommation de stupéfiants s’est instaurée à la fin du XVIII° siècle, a culminé au XIXe avec les fumeries d’opium, des endroits où vont se retrouver- en principe – des créateurs, avec le souci de prendre en commun un produit qui leur permettrait d’élargir leur champs de conscience, de développer leurs capacités artistiques.
J’évoque là un petit monde clos, douillettement protégé par de lourdes tentures d’inspiration orientaliste comme le veulent les standards de l’époque, quand on s’adonne aux douceurs d’une bonne pipe. Ce qui n’exclue ni la déchéance, ni l’overdose mortelle. Et c’est ici que se repère le lien entre vocation et addiction, dans ce sentiment d’être comme « dévolu » à l’art – ou à autre chose – mais aussi à l’emprisonnement.
Car la plupart des attitudes qui s’associent à l’addiction, appauvrissement des relations affectives et amoureuses (le produit remplace tout), détachement quant à l’environnement social – école buissonnière, arrêts de travail à répétition – mais aussi euphorie et accroissement de l’imagination, se retrouvent chez grand nombre d’individus engagés dans le très étroit sillon de la vocation.
Le phénomène de la drogue comme celui de la vocation s’inscrit donc en creux dans notre culture, il en marque les limites, la finitude. Car le sujet consommateur s’absente, plus ou moins délibérément, du champ social et de ses règles en supprimant ce qui en constitue l’essence, soit la relation d’altérité.
Lacan, Sade, Kant, et Dieu
Le sens premier du terme vocation est de nature religieuse et métaphysique. C’est un appel qui provient de Dieu. Du coup, celui ou celle qui le reçoit est confronté à une demande impérieuse qui ne lui laisse qu’une étroite marge de libre-arbitre. Comment résister à ce qui nous dépasse, qui s’inscrit en deçà et au-delà de nous ? Dans un de ses articles, publié en 1962 – Kant avec Sade, in Ecrits, Le Seuil, 1966, article destiné à présenter deux livres du marquis de Sade, Justine ou les malheurs de la vertu et La philosophie dans le boudoir, Lacan explique que le mal, selon Sade, est un équivalent du bien tel que le conçoit Kant. Pour Kant il existe, en chaque être humain, un amour du Bien sans que le sujet n’en possède une connaissance rationnelle que Kant va nommer Dieu.
Ce que Lacan s’essaie à démontrer c’est qu’il existe dans la perversion, soit l’amour de la transgression qui n’est pas, on le voit, sans rapport avec l’addiction, une caractéristique qui tend à amener le sujet à se donner en objet de jouissance offert à Dieu dans un désir inconscient d’anéantissement de soi. Or, c’est précisément dans cette néantisation de soi, cette tension permanente du sujet vers un seul et unique objet, métier, activité sportive, aspiration religieuse ou substance toxique que se noue le lien entre vocation et addiction.